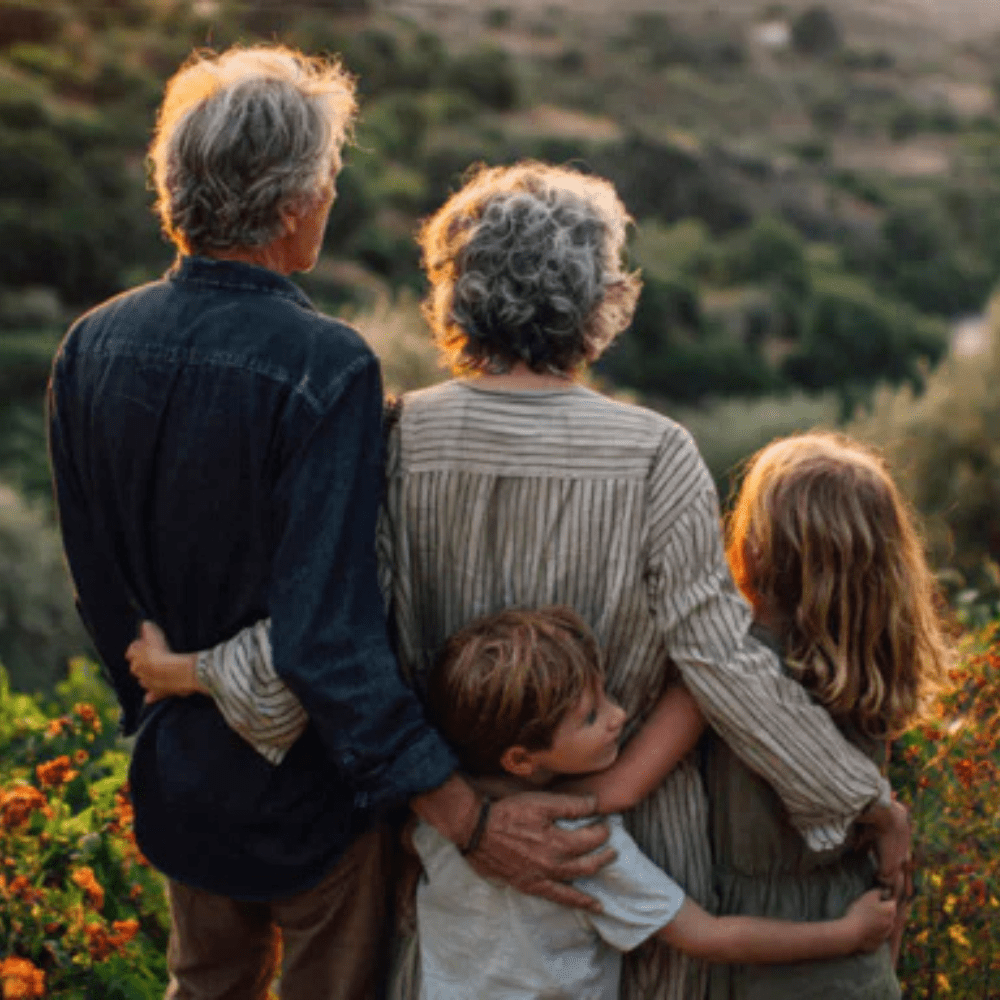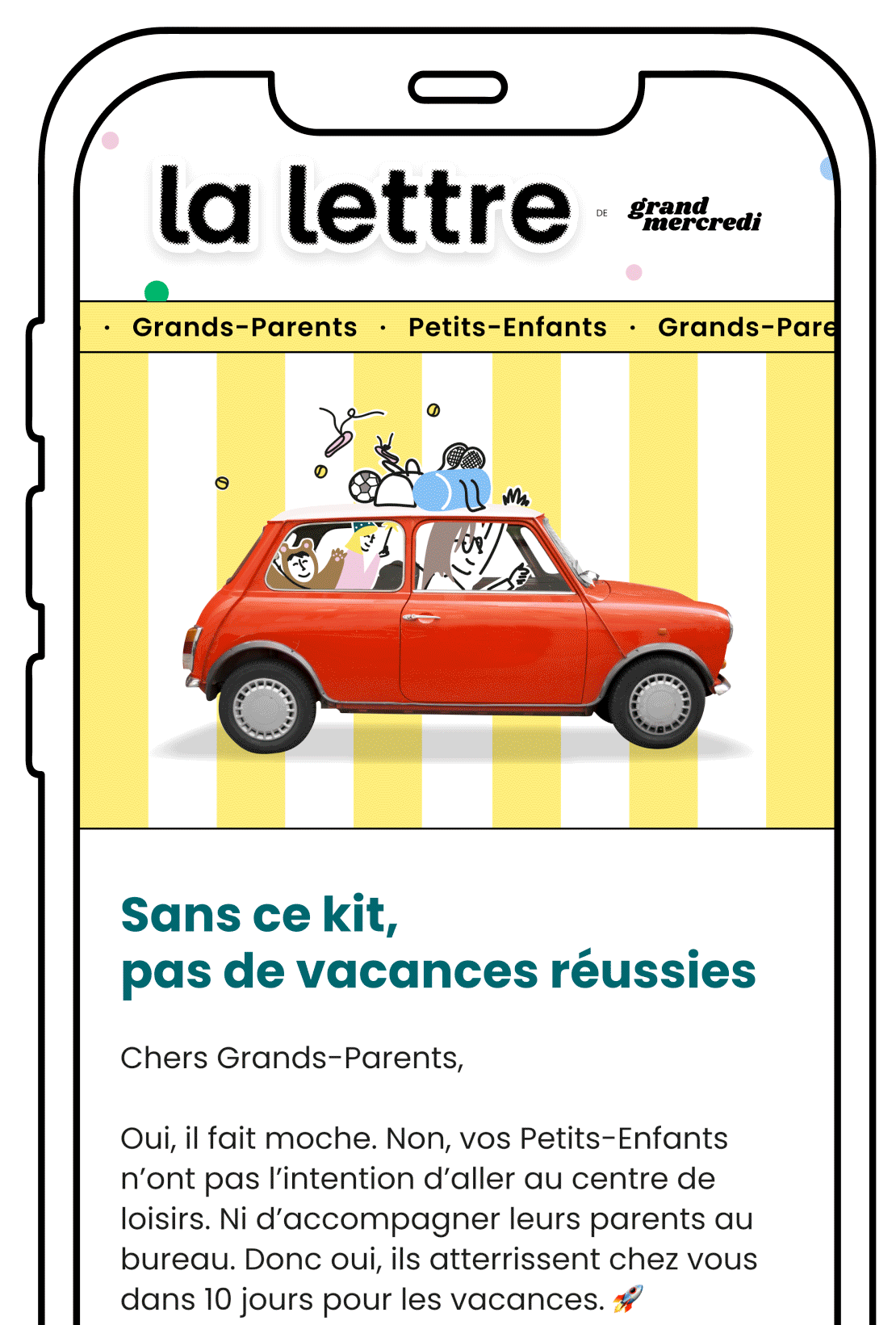Devenir grand-parent est, pour beaucoup, une joie immense. Mais pour d’autres, c’est une étape qu’ils redoutent, voire qu’ils refusent d’endosser. Ces « grands-parents malgré eux » existent, et leur choix soulève autant d’incompréhension que de tristesse dans les familles.
Pourquoi certains refusent-ils ce rôle ?
– Le sentiment d’être encore trop jeune : à 50 ou 55 ans, certains associent la grand-parentalité à la vieillesse et ne veulent pas « changer de camp ».
– Un mode de vie incompatible : voyages, carrière, nouvelles amours… Certains grands-parents estiment ne pas avoir de place pour un bébé dans leur quotidien.
– Une histoire familiale compliquée : tensions avec leurs propres enfants, blessures passées ou rancunes jamais réglées peuvent freiner l’envie de se rapprocher des petits-enfants.
– La peur des responsabilités : certains ne veulent pas être sollicités pour garder les enfants ou se sentent incapables d’assumer une présence régulière.
Témoignages
👵 Michèle, 54 ans au moment de sa première petite-fille
« Quand ma fille m’a annoncé qu’elle était enceinte, j’ai eu un choc. J’étais encore en pleine carrière, je voyageais beaucoup, je n’avais pas du tout envie de m’entendre appeler “mamie”. Pendant plusieurs années, je suis restée en retrait. Et puis, quand ma petite-fille a eu 6 ans, elle a commencé à m’appeler pour me raconter ses histoires d’école. C’est elle qui est venue vers moi. Aujourd’hui, je suis une grand-mère comblée… mais à retardement. »
👨🦳 Patrick, 60 ans, grand-père sur le tard
« Je ne me suis jamais senti fait pour m’occuper de bébés. Quand mes enfants m’ont confié leurs nouveau-nés, j’étais complètement maladroit. J’ai tenu mes distances, et je sais qu’ils m’en ont voulu. Mais à l’adolescence, j’ai trouvé ma place : parler musique, politique, plaisanter. Aujourd’hui, mes petits-enfants viennent me voir par choix, pas par obligation. C’est ma revanche. »
👵 Jacqueline, 72 ans, trois petits-enfants
« J’ai toujours refusé de jouer les baby-sitters. Mes enfants le savaient, je ne voulais pas revivre une maternité bis. Mais ça ne m’empêche pas d’être une grand-mère présente autrement : j’envoie des cartes postales, je les emmène au musée ou au théâtre quand ils sont plus grands. J’ai trouvé ma façon d’être grand-mère, même si ce n’est pas celle qu’on attendait de moi au départ. »
Le regard du psy
« Refuser d’être grand-parent n’est pas refuser d’aimer. C’est parfois protéger son espace, son identité, ou mettre des mots sur une peur. Mais pour éviter que cela ne devienne destructeur, il est essentiel de communiquer clairement, sans culpabiliser ni accuser. »
Comment réagir dans ces situations ?
– Accepter que tout le monde n’a pas la même vision de la famille.
– Chercher d’autres figures de transmission. Un oncle, une tante, un voisin proche peuvent jouer un rôle complémentaire.
– Ne pas couper le lien complètement. Même une relation ponctuelle — une carte envoyée, un appel à un anniversaire — peut compter énormément pour l’enfant.
Un phénomène encore tabou
Parler de grands-parents « absents par choix » reste délicat. La société valorise beaucoup l’image du grand-parent investi, complice, disponible. Mais il existe bel et bien une diversité de vécus — et les accepter, sans nier la douleur qu’ils peuvent provoquer, est un pas important pour mieux comprendre les dynamiques familiales d’aujourd’hui.
Auteur : La rédaction Grand-Mercredi
Crédit photo : ©pinterest